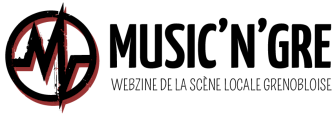Anciennement responsable d’antenne à Radio Campus Grenoble, co-fondatrice de Chica-Chic (ex- magasin de disques à Grenoble et structure de promotion des musiques underground allant vers ses 15 ans d’existence) organisatrice de soirées, réalisatrice radio et productrice : Isabelle Stragliati, connue sous l’appellation DJ Rescue, est bel et bien une artiste multi-facettes passionnée par la création sonore sous bien des formes. Évoluant depuis les années 2000 dans une carrière de Dj féminin pleinement assumée et revendicative, elle est reconnue aujourd’hui comme étant une figure incontournable du Grenoble underground. Elle revient aujourd’hui longuement sur l’évolution de sa carrière, témoin du besoin urgent de laisser les femmes s’emparer des platines.
Pourrais-tu nous expliquer l’origine de ton nom de scène, qui désigne « sauver », « secourir » ?
Ça vient des gouttes du même nom, que je prenais à mes débuts avant de mixer car je stressais trop… Mais le sens me va bien aussi : apporter du réconfort aux danseurs, sauver le dancefloor de la mauvaise musique !
Dis nous : lorsque tu mixes, qu’est ce que tu as envie de transmettre ?
Une énergie avant tout. Une furieuse envie de danser, d’être ensemble, de partager un voyage mental sonore qui va se traduire physiquement dans la danse. Je veux partager le plaisir et l’énergie que me donnent les tracks que je joue. C’est une énergie positive, et en tant que dj, quand le public est réceptif et l’exprime (oui parce être réceptif et rester au bar en secouant la tête ça marche pas !) tu reçois aussi l’énergie du dancefloor, qui peut être très puissante. Après ce genre d’échange, la sensation la plus proche que je connaisse c’est l’épuisement heureux et énergisant que tu ressens après avoir fait l’amour.
Y’à t il un(e) artiste qui t’a particulièrement influencée dans ta production musicale ?

Crédit : Marie Rouge
Je suis une grande fan d’Arthur Russell, un compositeur, chanteur et violoncelliste américain, mort du SIDA en 92 à l’âge de 40 ans. J’ai découvert sa musique il y a une dizaine d’années, je ne m’en lasse pas. J’y pense souvent quand je travaille sur de nouveaux tracks, c’est une vraie inspiration. Son œuvre est incroyablement riche, variée, toujours hyper novatrice. Il a su se renouveler constamment, en composant des morceaux house, disco, folk, musique contemporaine, minimaliste… En disco underground, on n’a pas vraiment réussi à faire mieux… On sent une grande liberté dans son travail : j’aime le fait qu’il fasse plusieurs versions d’un même morceau, qu’il réutilise les mêmes pistes pour différents projets. Ça m’a beaucoup inspirée aussi, c’est très avant-gardiste pour l’époque. C’est un immense compositeur, et un très grand interprète, c’est tellement injuste qu’il n’ait pas reçu la reconnaissance qu’il méritait de son vivant…
Si tu devais me citer une de tes productions qui te représentent le mieux ?
Ça ne fait pas très longtemps que je produis de la musique, je n’ai pas sorti grand chose : un court morceau abstract hip-hop que j’ai composé pour la vidéo d’un ami, un remix avec M-O-R-S-E, et les deux titres qui sont sortis avec OTTO RIITA.
J’ai un peu plus produit en radio, créa sonore, musique électroacoustique, donc ce qui me représente le mieux je dirais que c’est une créa radio qui mêle toutes mes influences : musique électronique, expérimentale, field recording, voix, littérature, vieilles pépites sonores… C’est une commande qui m’a été faite l’été dernier par Radio Campus Paris pour le réseau Radia, qui s’appelle o u r t i m e t o g e t h e r. C’est un journal sonore, un instantané de cet été là dont je garde un souvenir très sombre : le sort des réfugiés, les attentats de Nice, Orlando, le Brexit… avec un vrai besoin d’être ensemble. J’aime beaucoup cette pièce, qui n’est pas déprimante pour autant… enfin je ne crois pas !
Tu as commencé à mixer dans les années 2000. Que peux-tu nous dire de tes débuts dans ce milieu et de tes premiers projets ? Qu’est ce qui a impulsé la création du label indépendant Chica-Chic par exemple, il y a désormais plus de dix ans ?
J’ai commencé plus ou moins sur un coup de tête en 2002… inspirée par quelques modèles, malgré des rencontres manquées : Miss Kittin (on s’est croisées sur les bancs des beaux-arts de Grenoble), Sextoy (on s’est croisées dans les toilettes d’un café un après-midi de Gay Pride à Paris), et ma sœur Mafalda, qui a commencé à mixer avant moi (là ça va, on a fait un peu plus que se croiser).
Je retrouvais dans le mix ce qui me plaisait dans le montage quand je faisais des films aux beaux-arts. J’ai commencé en mixant assez downtempo : électronica plus ou moins barrée, abstract hip-hop, sur vinyles évidemment. Je suis tombée folle amoureuse de cette scène underground : Lex, Tigerbeat6, Anticon, Warp pour les plus connus… Mais aussi Sonig, Gagarin, Beta Bodega, Schematic, Merck… La création de Chica-Chic était une suite logique : les labels qui m’excitaient, on ne les trouvait qu’à Paris chez Bimbo Tower, qui ne faisait pas de vente à distance à l’époque. Pour acheter 10 vinyles, il fallait que j’en commande 5 aux Etats-Unis, 3 en Allemagne, 2 en Angleterre… avec les frais de ports qui allaient avec, ça faisait un certain budget. On s’est donc lancées avec Catherine, ma femme. On a commencé avec un shop en ligne, la distribution de labels auprès des disquaires indés, puis l’ouverture d’un magasin à Grenoble.
On n’y connaissait rien, on a fait plein d’erreurs, on a bien galéré, mais on a largement contribué, je crois, à faire connaitre cette scène en France. On était passionnées, ce qui importait avant tout était de promouvoir les artistes qu’on aimait, et ça passait aussi par une émission de radio, l’organisation de soirées, la promo dans la presse. Notre premier fait d’arme a été d’organiser une mini tournée pour les boss de deux labels de Miami : La Mano Fria du label Beta Bodega et Supersoul de Metatronix. En quelques jours, alors qu’on n’avait aucun contact dans le milieu, on leur a dégoté trois dates en France : Grenoble, Marseille, Toulouse.

On a tout géré, on n’a rien gagné, mais c’était vraiment chouette. Mon premier set en public c’était d’ailleurs à cette occasion. C’était en 2003 à l’ADAEP (Ampérage), j’avais préparé mon set comme une malade, j’étais terrorisée – même s’il n’y avait pas plus de dix personnes dans la salle en début de soirée. Par la suite j’ai surtout mixé dans des bars ou en première partie de concerts, dont TTC, Tarwater…
Mon premier set danceflloor c’était quelques années plus tard, encore une fois à l’ADAEP, une soirée organisée avec un certain Mosde – le nom parlera aux vieux de la vieille ! On avait invité Xerak et Léonard de Léonard, je faisais le warm up et je jouais entre les lives. Au début les gens criaient, je croyais qu’ils n’étaient pas contents, je flippais ! Puis j’ai compris qu’en fait ils kiffaient, et là ça a été la révélation. Mais la grosse claque, la soirée qui m’a définitivement ralliée à la cause du dancefloor, c’est ma première soirée au Pulp, mon premier set dans un vrai club en fait, en 2006. (…) J’ai mixé 2h30, je n’avais jamais joué aussi longtemps, le public était incroyable, une énergie de dingue. L’euphorie totale… sans drogue !
Tu as très vite tenté de promouvoir une scène musicale indépendante encore méconnue. Et surtout de la place de la femme dans ce milieu. Aujourd’hui, tu soutiens le Djing féminin à travers notamment le Grenoble Mixing Girls Club que tu as créé : peux-tu nous dire ce qu’est exactement ce collectif, et ce qu’il représente pour toi ?
A mes débuts je ne me posais pas vraiment la question de ma place en tant que fille. J’étais portée par le projet Chica-Chic, j’avais tellement de casquettes (DJ mais aussi disquaire, tour manager, organisatrice de soirée, animatrice radio…), j’imagine que ça me légitimait d’office. Je ne ressentais pas le besoin de me justifier, de m’imposer, alors que j’étais la plupart du temps la seule fille. En arrêtant progressivement les activités de Chica-Chic, cela m’a obligée à me recentrer sur mon activité de DJ, la faire vivre en tant que telle, ça a un peu changé la donne. C’est à cette époque (juste après la fermeture du magasin en fait), que j’ai lancé, avec l’aide de Mag, les soirées Blonde on Blonde à Grenoble, avec une programmation quasi exclusivement féminine. Je continue depuis, même si évidemment il m’arrive d’inviter des DJs ou producteurs masculins si j’aime ce qu’ils font.
En 2015 j’ai effectivement impulsé la création du Grenoble Mixing Girls Club, mais je n’en fais plus partie. Je n’avais plus le temps ni l’énergie nécessaire pour participer aux discussions et prises de décisions. Mais l’idée de ce collectif est partie d’un constat simple : ça fait 15 ans que je mixe, et j’étais, avant la création du collectif, la seule femme DJ – et pas « Djette » par pitié ! – à me produire régulièrement à Grenoble.

Solutricin était également présente, par intermittence, dans d’autres réseaux. Pour une ville de la taille de Grenoble, ça dit quelque chose… L’idée c’était de rassembler, de fédérer, donc de créer un collectif ouvert à toutes les femmes (ou personnes s’identifiant comme telle), DJs et selectors de l’agglomération grenobloise. Je souhaitais une ouverture au-delà du niveau technique, des affinités de style et des crews. Le but : apporter de la visibilité au DJing féminin et susciter des vocations. C’est encore ce que j’ai envie de transmettre : montrer aux filles plus jeunes que ce n’est pas un domaine réservé aux garçons, qu’on y a notre place comme ailleurs.
La place des femmes dans ce milieu a-t-il évolué selon toi depuis les débuts de ta carrière ?
Il y a plus de femmes, qui commencent plus jeunes, qui apprennent très vite et qui sont très douées, comme Calling Marian par exemple. Cela montre que le travail des pionnières commence à payer. Mais on est encore loin du compte quand on voit la programmation des clubs et des festivals, ou quand on lit des propos d’une misogynie sans nom comme ceux de Konstantin la semaine dernière.
On se prend moins de remarques du style « Tu mixes bien pour une fille ». Par contre, ce n’est pas rare que des mecs me fassent signe de sourire quand je mixe, ce qu’on ne les imagine pas faire avec un DJ masculin… Ou qu’ils se mettent en bande juste devant les platines et adoptent une attitude déplacée : moqueuse, méprisante, envahissante, etc. J’imagine qu’au fond, une fille qui mixe de la grosse techno sans sourciller et sans être dans la séduction, ça les dérange.

Sur quels autres projets te concentres-tu aujourd’hui ? La production de musique concrète ne serait qu’une partie de l’ensemble de ton travail… Peux-tu nous en parler ?
Je travaille actuellement à l’écriture d’un docu-fiction radio qui a pour sujet une enquête sur le personnage d’un film dans Bruxelles… c’est un projet de longue haleine, démarré il y a plus d’un an. J’attends des financements, j’ai hâte qu’il se concrétise.
J’ai un autre docu sur le Planning Familial et le féminisme sur le feu depuis plusieurs mois… J’aimerais bien refaire un numéro de ma série d’émissions de créa radio Dream.Like.Sound, sur le thème du genre… Mais je veux aussi passer du temps sur la prod musicale, explorer des voies, des outils que je connais peu.
Je travaille également à de nouveau morceaux pour le duo OTTO RIITA que je mène avec Yugo Solo, (ex-guitariste du groupe grenoblois RIEN), et on a le projet de préparer un live. Notre EP Azul Piscina va bientôt sortir en cassette !
Peux-tu nous dire un mot sur tes deux prochaines dates à Grenoble ?
Je joue le 7 juillet au Vertigo, pour la soirée Weird Tanz initiée par Keep it Weird, avec Aymeric Ponsart. Je suis contente, je n’ai jamais joué au Vertigo, et avec Aymeric on se connait depuis longtemps, on fait un peu office de vétérans ! On s’entend bien, on a la même vision de la musique : passionnée, underground, sans concession.
Et le 18 juillet c’est la 58eme édition de la Go Bang!, ma résidence à la Bobine et je suis ravie d’y accueillir Calling Marian pour sa première date à Grenoble…